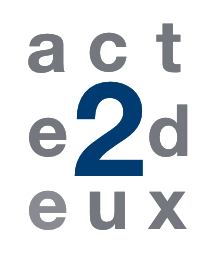Extrait de Théâtres intimes, Actes Sud, 1989
Extrait de Théâtres intimes, Actes Sud, 1989
« Epilogue dramatique » : c’est ainsi qu’Ibsen qualifiait Quand nous nous réveillerons d’entre les morts (1899), la pièce qui, écrite peu avant son attaque d’apoplexie, fut son ultime œuvre littéraire. La formule convient parfaitement à ce drame où un grand sculpteur et son ancien modèle ne se retrouvent après des années de séparation que pour se déclarer leur amour mutuel et marcher ensemble à la rencontre de la mort ; mais elle éclaire également la production dramatique antérieure de l’écrivain norvégien depuis Maison de poupée (1879). Chacun des drames intimes – ou « domestiques » – d’Ibsen se présente, en effet, comme l’épilogue d’un roman non écrit dont la matière constituerait la trame et l’aliment exclusif de l’action dramatique. Lorsqu’ils entrent en scène, les personnages de Hedda Gabler ou de Rosmersholm, du Canard sauvage ou de Solness le constructeur ont déjà incubé comme une maladie ce « roman familial » qui couvre leur existence commune et remonte jusqu’avant leur naissance. Il ne leur reste plus qu’à en jouer le climax, le dénouement, la Catastrophe. « Tout est déjà là et n’est que porté au jour », pour reprendre l’analyse d’Œdipe roi par Schiller déjà appliquée par Peter Szondi au drame ibsénien.
Cependant, dans la dramaturgie ibsénienne, à la différence de la sophocléenne, ce sont moins des faits – comme avoir tué son père et épousé sa mère – qui émergent du passé et contaminent le présent qu’un sentiment diffus de culpabilité. Objectivement, les personnages ibséniens n’ont rien de plus grave à se reprocher que quelques lâchetés, négligences ou malversations ordinaires. Subjectivement, ils se sentent coupables au dernier degré. Chez Ibsen, le tragique n’est pas relié à un événement ou à une fatalité extérieurs au personnage mais déterminé par un état et une évolution psychiques internes qui, à la limite, n’ont d’existence que pour ce seul personnage. A l’inverse de l’Œdipe de Sophocle, qui reste jusqu’au dernier moment dans l’ignorance de la faute qu’il a commise malgré lui, le personnage ibsénien est, d’entrée de jeu, miné par le sentiment d’une faute qu’il n’a peut-être pas commise.
Dans l’intime de l’être…
Maeterlinck a donné un nom paradoxal à ce tragique moderne qui s’impose à partir d’Ibsen; il l’a appelé le « tragique du bonheur ». Tragique de la « vie immobile » que traduira un « théâtre statique » : « Est-il donc hasardeux, s’interroge le poète et dramaturge belge, d’affirmer que le véritable tragique de la vie, le tragique normal, profond et général, ne commence qu’au moment où ce qu’on appelle les aventures, les douleurs et les dangers sont passés ? Le bonheur n’aurait-il pas le bras plus long que le malheur et certaines de ses forces ne s’approcheraient-elles pas davantage de l’âme humaine ? ( … ) N’est-ce pas quand un homme se croit à l’abri de la mort extérieure que l’étrange et silencieuse tragédie de l’être et de l’immensité ouvre vraiment les portes de son théâtre? » Hedda Gabler ou Hialmar Ekdal nous paraissent d’autant plus pitoyables que le bonheur – entendons une existence familiale paisible et harmonieuse – est à tout moment à portée de leur main et qu’ils sont incapables de le saisir, et qu’ils se laissent submerger par un malheur d’origine inconnue, souterraine. L’être intime des principaux personnages ibséniens est le site de cette fatale résurgence, le lieu où ils ne cessent de ruminer, de ressasser, jusqu’à la Catastrophe, en une sorte de cure mortifère, de psychanalyse à l’envers, leur « roman familial ». Après celle du grand (Edipe, le théâtre d’Ibsen n’inaugure-t-il pas l’ère des petits œdipes que nous sommes tous au-dedans de nous-mêmes ? Métamorphose que nous avait laissé pressentir, en se situant à mi-chemin du héros antique et du « petit homme » moderne, le Hamlet de Shakespeare.
Déjà Hamlet puisait son infortune dans ses soupçons, dans ses visions et dans ses fantasmes ; son destin procédait d’une intériorité maladive tout autant que de l’événement extérieur. Hedda et Hialmar parachèvent cette subjectivisation du malheur. Le tragique moderne, dont Ibsen établit les prémices, ne nous donne plus à voir la grandiose culbute d’un héros mais le périple immobile, le long stationnement au bord du vide d’hommes ordinaires en proie à la pulsion de mort. La névrose et tout le cortège des maladies de l’âme font leur entrée sur la scène. Désormais, les retournements de fortune, les péripéties n’auront d’autre théâtre que celui de l’être intime. Ainsi de la Rebecca West de Rosmersbolm, que Freud, précisément, érigera en personnage emblématique de ces névrosés qui « échouent devant le succès » : après avoir souhaité conquérir Rosmer et son domaine et au moment où cet homme lui propose le mariage, elle ne consent qu’à aller se jeter dans le torrent avec lui. Quelques années avant les principales découvertes du freudisme, Ibsen dote ses personnages d’une psyché qui déborde largement leur conscience et ne cesse de la troubler. Et, tout en prétendant préserver l’intégrité de la forme et de l’action dramatiques, il transforme la scène, quasiment malgré lui, en un écran sur lequel seront projetés les scénarios fantasmatiques et les pulsions inconscientes de ses personnages.
Le rôle-titre du Petit Eyolf, un garçon infirme de neuf ans, meurt par noyade – d’une mort qui ressemble étrangement à un suicide – à l’instant même où, sur la scène, sa mère est en train de trahir, devant son mari, son désir subconscient de cette disparition :
« RITA. Tu ne peux pas prononcer le nom d’Eyolf sans émotion, sans que ta voix tremble. (D’une voix menaçante, les poings serrés.) Ah ! je souhaiterais presque… Enfin!
ALLMERS (avec un regard anxieux). Que souhaiterais-tu, Rita ?…
RITA (avec emportement, s’écartant de lui). Non, non, non, je ne veux pas le dire. Je ne le dirai pas!
ALLMERS (s’approchant d’elle). Rita !Pour ton propre bonheur comme pour le mien, je t’en supplie, ne te laisse pas aller à de mauvaises pensées. »
La coïncidence entre la pulsion infanticide jusqu’alors refoulée et le tragique « accident » est trop forte pour qu’on n’invoque pas ce chapitre clé de l’Interprétation des rêves où il est question du « rêve de la mort de personnes chères ». D’autant que l’émergence progressive du roman implicite confirme l’hypothèse d’une cohérence onirique du drame de la mort du Petit Eyolf. Un peu plus tard, Allmers prend Asta à témoin de son désespoir et lui demande : « Est-ce donc vrai, Asta ? Ou suis-je devenu fou? Ou bien n’est-ce qu’un songe ? Oh, si ce n’était qu’un songe ! Quelle joie, dis, si j’allais m’éveiller? » Gageons que, si Allmers était un simple mortel et non point un personnage de théâtre – d’un théâtre qui explore les régions les plus secrètes de l’âme -, il s’éveillerait… ainsi qu’il nous arrive, à chaque fois que nous rêvons de la mort d’un être cher et que ce cauchemar nous devient insupportable !… On apprendra également qu’Eyolf – le Grand Eyolf – est le prénom masculin dont Allmers affublait dans l’enfance (sans doute pour masquer une attirance incestueuse) sa demi-sœur Asta et que Rita, épouse sensuelle et jalouse d’Allmers, a découvert cette communauté de prénoms entre son fils et sa belle-sœur. Quant au dialogue conflictuel qui s’instaure entre les époux, après la mort du Petit Eyolf, c’est une mine de révélations.
Lorsque le Petit Eyolf a fait, étant bébé, cette chute qui l’a rendu infirme, ses parents étaient en train de faire l’amour. « Il dormait d’un si bon sommeil », objecte Rita pour se disculper ; mais, quelques répliques plus tôt, confondant ce premier accident et le second, qui fut fatal à l’enfant, elle se contredit et évoque un Petit Eyolf « étendu au fond du fjord. Tout au fond, sous l’eau transparente ( … ) étendu sur le dos, les yeux grands ouverts ». C’est donc sous le regard bien ouvert de son fils que Rita se revoit faisant l’amour avec son mari.
Comment, dès lors, ne pas reconnaître, dans ce que Rita appelle pudiquement 1″‘heure furtive ( … ) cette heure de feu et d’irrésistible beauté », la scène originaire freudienne dont Rita et Allmers restent à jamais les acteurs culpabilisés et le Petit Eyolf l’innocente victime ? « Qui sait, s’interroge Allmers, s’il n’y a pas deux grands yeux d’enfant qui nous regardent nuit et jour ? »… Le roman personnel sous-jacent au drame est constitué par un réseau serré de pensées associatives où s’exprime, selon un processus analogue à l’anamnèse de la psychanalyse, l’inconscient des personnages. Force est de se rendre à l’intuition de Maeterlinck selon laquelle Ibsen aurait « tenté de mêler dans une même expression le dialogue intérieur et extérieur. ( … ) Tout ce qui s’y dit cache et découvre à la fois les sources d’une vie inconnue. Et si nous sommes étonnés par moments, il ne faut pas perdre de vue que notre âme est souvent, à nos propres yeux, une puissance très folle, et qu’il y a en l’homme des régions plus fécondes, plus profondes et plus intéressantes que celle de la raison ou de l’intelligence… » Contrairement à ce que fera plus tard O’Neill, distinguant et articulant, dans L’Etrange Intermède, dialogue et monologue intérieur, Ibsen prépare en secret l’amalgame du dialogue extérieur et du soliloque intime, du réalisme et de l’onirisme. A nous de savoir entendre l’inconscient des personnages et voir 1″‘autre scène » derrière le réalisme bourgeois apparent de cette dramaturgie. Toujours est-il que l’intime du personnage ibsénien se trouve mis à découvert. À la différence du drame bourgeois, l’intimité n’apparaît plus ici comme le vêtement négligé et confortable de l’individu socialisé, mais comme une dernière protection, qui ne peut manquer de tomber, serait-ce au prix d’une désintégration de l’être lui-même.
Avec Ibsen, pour la première fois au théâtre, le drame domestique devient drame intime. L‘intrasubjectivité (relation du personnage avec la part inconnue de lui-même) empiète sur l’intersubjectivité (relation que les différents personnages entretiennent ensemble) ; la parole intime prend le pas sur la parole partagée. Aussi perspicaces qu’elles soient, les analyses de Peter Szondi sous-estiment le rôle de l’intime et de la subjectivité dans la dramaturgie ibsénienne. « La représentation dramatique ibsénienne, peut-on lire dans Théorie du drame moderne, reste reléguée dans le passé et dans l’intériorité. C’est bien là le problème de la forme dramatique chez Ibsen’. » Il est vrai que, dans presque tous ses drames domestiques, Ibsen croit devoir compenser le déficit en action dramatique qu’engendrent l’intériorisation et la rétrospection par un mouvement et une construction dramatiques « scribéens » en trompe-l’œil. Quelquefois, en effet, on est frappé par une contradiction flagrante entre la forme et la matière du drame : rythmes antagoniques du travail intérieur de remémoration et du carrousel endiablé de personnages qui, dans Hedda Gabler, ne font qu’entrer et sortir; antinomie de la multiplication et de la succession rapide des scènes avec la lenteur obligée des conversations… Il n’en reste pas moins que la critique de Szondi, trop prompte à démêler une crise définitive de la forme dramatique et peut-être aveuglée par son allégeance au théâtre épique de Brecht, passe à côté de l’apport décisif du théâtre d’Ibsen : l’invention d’une dramaturgie de la subjectivité (cette même subjectivité sur laquelle le théâtre de Brecht fera l’impasse) dont le ressort principal est, précisément, le travail du passé dans l’intériorité.
Maison hantée, vie fantôme
Le drame ibsénien reprend la structure spatiale du drame bourgeois – le fameux « salon » -, mais en la retournant. Dans le théâtre des Lumières, l’espace intérieur, celui de l’intimité familiale, est constamment menacé par un espace extérieur fauteur de troubles : la crise du Père de famille de Diderot s’ouvre avec une maisonnée en alarme parce que le fils, Saint-Albin, vient de découcher pour la première fois, et elle ne se résoudra que lorsque ce même Saint-Albin sera parvenu à faire accepter par son père et dans sa maison cette Sophie qu’il était allé retrouver dans sa mansarde. Dans les pièces d’Ibsen, au contraire, malheurs et malédictions sont d’emblée installés dans la maison, au cœur de l’espace intime. Des années durant, Mme Alving, des Revenants, a éloigné son fils de sa propre maison afin de le protéger d’un « milieu de souillure » où il ne pouvait que « s’empoisonner ». D’apparence calme et immobile (« Ici, c’est toujours aussi calme. Les jours se suivent et se ressemblent », note Rebecca West au début de Rosmersbolm), la maison ibsénienne renferme un air corrompu par d’anciennes et inexpugnables fautes et par des scandales d’autant plus pernicieux qu’ils ont été étouffés entre les quatre murs. Respirer l’atmosphère de la maison suffit à se charger de ces fautes et à endosser la culpabilité des scandales. « Tout cela dans cette maison, dans cette maison ! » s’écrie le pasteur Manders lorsqu’il apprend la vérité sur le capitaine Alving, sa vie de débauche et ses amours ancillaires. La veuve, qui vient de faire cet aveu, n’a plus elle-même la force de rejeter la faute sur son défunt mari s’adressant à son fils, elle s’enlise dans la culpabilité ‘le crains d’avoir rendu la maison insupportable à ton pauvre père, Oswald. »
L’espace extérieur – le « fjord mélancolique » – n’est certes pas moins sombre que celui de la maison, mais, ici, la nature, le cosmos ne font que refléter l’espace intime, comme ces premiers rayons du soleil matinal qui déclencheront la folie autodestructrice d’Oswald
« Mère, donne-moi le soleil ( … ) le soleil… le soleil !… » Un lieu hanté où les morts pèsent sur les vivants et déterminent leur existence, telle est la maison. Une fois refermée l’heureuse parenthèse des années de jeunesse passées à Paris, Oswald se replie « comme un mort vivant » dans la maison qui l’a vu naître ; il tente de séduire la jeune bonne – qui se révélera sa demi-sœur : la fille naturelle du capitaine et d’une domestique – et, sous le regard halluciné de sa mère, reproduit les comportements de son père:
« MADAME ALVING. Des revenants. Le couple du jardin d’hiver qui revient ( … ).
LE PASTEUR. Comment avez-vous dit ?
MADAME ALVING. J’ai dit un monde de revenants. Quand j’ai entendu là, à côté, Régine et Oswald, ç’a été comme si le passé s’était dressé devant moi. Mais je suis près de croire, pasteur, que nous sommes tous des revenants. Ce n’est pas seulement le sang de nos père et mère qui coule en nous, c’est encore une espèce d’idée détruite, une sorte de croyance morte, et tout ce qui s’ensuit. Cela ne vit pas, mais ce n’en est pas moins là, au fond de nous-mêmes, et jamais nous ne pourrons nous en délivrer. »
Quant à la belle, sensuelle et libre Rebecca West, j’ai déjà évoqué la dégradation progressive, sous l’emprise de la « Maison-Rosmer », de son appétit de la vie et de l’amour en un besoin de paix que les psychanalystes appelleraient « pulsion de nirvâna » : « Rosmersholm m’a volé ma force. Ici, on a rogné les ailes de ma volonté. On m’a mutilée. Le temps n’est plus où j’aurais pu oser n’importe quoi. J’ai perdu la faculté d’agir, Rosmer ( … ). C’est arrivé peu à peu – tu comprends. C’était presque imperceptible au début – et à la fin tout était changé. J’ai été atteinte jusqu’au fond de mon âme ( … ). Tout le reste – ce qui était laid – le désir, l’ivresse des sens – m’a paru si loin, si loin. Toute cette agitation des instincts s’est calmée – jusqu’au silence. J’ai connu une paix profonde – un silence comme celui qui règne là-haut, chez nous, sous le soleil de minuit, sur les rochers où nichent les oiseaux. »
Toutes les maisons ibséniennes sont pareilles à Rosmersholm – « où, comme l’écrit Bernard Dort, les enfants ne crient pas et où personne ne rit jamais. » : maisons hantées, maisons-tombeaux. Si la maison possède ce pouvoir mortifère, c’est qu’elle n’est pas ou n’est plus, pour reprendre un terme qui exprime toute la nostalgie de Solness l’architecte, un « foyer »… « Abandonner ton foyer, ton mari, tes enfants ! » s’exclame Helmer lorsque Nora lui fait part de sa décision de déserter le domicile conjugal ; et l’épouse de rétorquer que ce « foyer » n’est plus, dès lors que l’amour s’en est retiré, qu’une « maison » : « J’avais vécu dans cette maison huit années avec un étranger et ( … ) j’avais eu trois enfants… Ah! je ne puis seulement pas y penser! » « Maison de poupée », qui ne saurait produire qu’une vie naine, atrophiée, mutilée. De même que l’espace extérieur – immensité neigeuse ou océane – métaphorise l’aridité intime, l’espace intérieur trahit l’humanité blessée de ceux qui l’habitent. jamais le « grand salon » de Hedda Gabler ne deviendra ce lieu intime où pourrait se consolider le couple disparate que forment la fille du général et Tessman, son époux : à la première, il manquera toujours un nouveau piano, un maître d’hôtel, une vie mondaine pour que ce lieu corresponde à ses fantasmes d’aristocrate ; et, sur le second, cette demeure trop luxueuse, à l’opposé du « foyer » dont il rêvait, pèsera toujours comme un fardeau. Le Canard sauvage illustre parfaitement ce conflit de la maison et du foyer. Tout le drame se trouve résumé dans l’opposition de l’imposante maison de l’industriel Haakon Werlé, fréquentée par les notables, et du modeste foyer qui abrite Hialmar Hekdal, son épouse Gina, leur fille Hedwige et le Vieil Hekdal, ancien associé de Werlé mis au rancart. Par l’entremise de Grégoire Werlé, fils d’Haakon et dangereux sectateur de la vérité, la maison va ruiner le foyer, provoquer le rejet par Hialmar de sa vie familiale et le suicide d’Hedwige.
Mais la funeste domination du foyer par la maison renvoie, bien sûr, à un autre écrasement : celui de la conscience des personnages par ces puissances invisibles qui hantent leur être intime. Freud a mis en lumière l’analogie de la maison et du moi: « Dans certaines maladies et de fait dans les névroses ( … ) le moi se sent mal à l’aise, il touche aux limites de sa puissance en sa propre maison, l’âme. Des pensées surgissent subitement dont on ne sait d’où elles viennent ; on n’est pas non plus capable de les chasser. Ces hôtes étrangers semblent même plus forts que ceux qui sont soumis au moi. » Cette part occulte de lui-même, son inconscient, le Solness d’Ibsen lui a même donné un nom imagé : il l’appelle « ses trolls », du nom des génies qui hantent Peer Gynt… Ainsi se présentent la plupart des créatures d’Ibsen : leur moi « n’est pas, dirait Freud, maître dans (leur) propre maison ». La partie obscure de leur psyché annihile en eux l’instinct de vie, les métamorphose en « morts vivants » et transforme leur existence en un fantôme de vie. Les personnages ne cessent de pleurer leur « vie perdue », leur « vie gâchée » (Allmers, dans Le Petit Eyo~f- « Il n’y a plus pour moi de vie à vivre » ; Irène à Rubek, dans Quand nous nous réveillerons d’entre les morts – « Le désir de vivre est mort en moi, Arnold ( … ). Je m’aperçois que toi et la vie… vous n’êtes que des cadavres au tombeau… comme je le fus moi-même »), et ce leitmotiv structure le drame, lui confère sa structure spatio-temporelle.
Avant-dernière pièce d’Ibsen, Jean-Gabriel Borkman porte ces thèmes fondamentaux à leur point culminant. La grande maison de Jean-Gabriel Borkman, qui fut autrefois riche et puissante, n’est plus qu’une espèce de caveau conjugal où se tiennent emmurés, dans deux appartements différents, l’ex-banquier et son épouse Gunhild. Depuis de longues années, les époux ruminent séparément à huis clos la chute de leur empire et de leur maison. Lorsque Borkman a la velléité de sortir de son enfermement volontaire, de renouer avec la vie en reprenant ce combat financier messianique qui l’entraîna jadis en prison, Gunhild le renvoie implacablement à son état de mort vivant:
« BORKMAN. On dirait vraiment que je suis mort!
MADAME BORKMAN (d’un ton ferme). Tu l’es(… )Ne rêve plus jamais de vivre ! Reste étendu où tu es
Au vrai, ce n’est pas tant l’expiation du crime financier que celle d’une faute plus secrète, un crime contre l’amour, progressivement révélé au cours de la pièce, qui a transformé la demeure des Borkman en maison hantée et leur existence en vie fantôme. Borkman a, dans sa jeunesse, renoncé à son amour partagé pour Ella, la sœur jumelle de son épouse Gunhild, afin de mieux asseoir sa puissance. « Tu es un meurtrier! jette à la figure de Borkman Ella, sa belle-sœur. Tu as commis le grand péché de mort ! ( … ) Tu as tué en moi la vie d’amour ( … ). Tu n’as pas craint de sacrifier à ta cupidité ce que tu avais de plus cher au monde. En cela tu as été doublement criminel. Tu as assassiné ta propre âme et la mienne ! » Pulsion de vie retournée en pulsion de mort ; existence convertie en deuil permanent.
Le propre de la névrose, nous dit Freud, est de rendre l’amour impossible. Et ce manque plonge les personnages ibséniens au plus profond de la mélancolie. De même que la psychanalyse nous ramène des conflits que nous vivons avec d’autres individus vers ceux que nous avions, sans le savoir, avec nous-mêmes, le théâtre d’Ibsen fait parcourir à ses personnages le chemin qui les conduit de leurs affrontements avec leurs proches, leur entourage, la société jusqu’à leurs déchirements intimes. Dans les deux cas, cela se fait à la faveur d’une émergence progressive des pensées inconscientes. « Il est si facile de perdre la mémoire de soi-même », constate Mme Alving. Tout au long du drame ibsénien, ce n’est pas seulement le passé des personnages – leur roman familial – qui remonte à la conscience des personnages, mais, comme dans une psychanalyse, ce qui, dans ce passé, fait sens, ce qui a été refoulé et, du même coup, se répète inconsciemment dans le présent et obère l’avenir. Mais l’analogie du théâtre ibsénien et de la psychanalyse s’arrête là : le but de celle-ci est de tenter de rendre à la vie ses patients ; la tension de celui-là, théâtre du tragique domestique et intime, ne saurait être que la mise à mort du personnage : la pulsion de mort dans son cours irrépressible et suicidaire, telle qu’elle s’exprime dans l’objurgation d’Oswald à sa mère, Mme Alving : « Quelle sorte de vie m’as-tu donnée? je n’en veux pas! Reprends-la ! «
Scène d’amour au seuil de la mort
Le cours de la « vie perdue » n’est pas susceptible d’être redressé. Le seul salut que puissent espérer les personnages, c’est une miraculeuse renaissance, un « réveil d’entre les morts » à la fois intime et cosmique, un « revivre » aussi éclatant qu’éphémère. « Oh! Que ne puis-je revivre ! – faire que tout cela ne soit pas arrivé ! » s’exclame Oswald, le petit œdipe, dans ce même délire où il demande à sa mère de lui donner le soleil. Eblouissement : ultime et première jouissance concomitante d’une mort dont la mère serait la pourvoyeuse. Dételer cette « vie gâchée » et en inaugurer une nouvelle, fût-elle extrêmement brève, fût-elle rêvée, c’est le sens de l’épilogue, de la Catastrophe en forme de Gloire qui clôt plusieurs drames d’Ibsen. Epilogue doit ici être entendu dans une seconde signification, complémentaire de celle, précédemment dégagée, qui fait du drame le dénouement du roman non écrit : une scène d’amour au seuil de la mort présente, en filigrane, dans toutes les pièces et, de façon manifeste, dans Rosmersbolm et dans la dernière, Quand nous nous réveillerons d’entre les morts.
Aux dernières secondes de Rosmersbolm, Mme Helseth, la gouvernante, se fait, auprès du public, la messagère quelque peu mystifiée de la bienfaisante Catastropbe: » (regardant autour d’elle). Sortis ? Dehors, tous les deux, à cette heure-ci ( … ). (Se dirigeant vers là,fenêtre et regardant au-dehors.) Seigneur Jésus ! Cette tache blanche, là-bas_ ! Oh, mon Dieu, ils sont tous les deux sur le pont ! Ayez pitié des pauvres pécheurs. Ne voilà-t-il pas qu’ils s’embrassent ! (Poussant un grand cri.) Oh – par-dessus le parapet -, tous les deux ! Droit dans le torrent. Au secours ! Au secours ! » Quant aux amants de Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, ils mettent fin à des années de vie « séparée » et « gâchée » en escaladant la montagne et en allant au-devant d’une avalanche qui sera leur lit nuptial et, aussi, leur linceul :
« RUBEK (la saisissant violemment dans ses bras). Eh bien, veux-tu qu’en une seule fois nous vivions la vie jusqu’au fond… avant de regagner nos tombes ?…
IRÈNE. Dans la splendeur lumineuse des sommets, sur la cime de l’oubli!
RUBEK. Irène, mon adorée… oui, c’est là que nous célébrerons notre fête nuptiale ( … ).
IRÈNE (comme transfigurée). Je suivrai volontiers, sans réserve, mon màltre et seigneur.
RUBEK (l’entraînant). D’abord, Irène, nous fendrons les brouillards et puis…
IRÈNE. Oui, à travers les brouillards vers les sommets, où resplendit le soleil levant.
Les nuées descendent et s’épaississent. Rubek et Irène, la main dans la main, montent, traversant le névé et disparaissent bientôt dans le brouillard qui tombe.
La scène d’amour au seuil de la mort peut se présenter, dans les autres drames, sur un mode plus discret ou dégradé, elle n’en constitue pas moins, dans son ambivalence de mort-résurrection, la seule issue possible au tragique ibsénien : Solness grimpant en haut de la tour, en communion télépathique avec Hilde, puis s’écrasant aux pieds de la jeune fille; Mme Alving sur le point d’offrir à Oswald, d’un même geste, la mort et le soleil orgastique qu’il réclame ; Allmers et Rita, les parents du Petit Eyolf, regardant ensemble, statufiés, « vers les sommets, vers les étoiles. Et vers le grand silence » ; Ella et Gunhild, les jumelles rivales, penchées sur la dépouille mortelle de Borkman telles « deux ombres au-dessus du mort » ; ou encore, dans un esprit plus ironique, Helmer se mettant à espérer, aussitôt que Nora a quitté la « maison de poupée », « le plus grand des prodiges » et Hedda-Lovborg se donnant tous deux la mort – l’une volontairement, l’autre dans une sorte d’acte manqué – tandis que Tesman et Mme Elvsted s’efforcent de reconstituer le manuscrit br-ûlé, cette relique.
Dans sa dimension sacrificielle, le suicide du couple, à quoi se résume la scène d’amour au seuil de la mort, ressortit plus à une élévation qu’à une chute. Assomption des amants ou des époux par la force de l’amour retrouvé. Perte qui est aussi un gain, comme l’affirme Allmers à Rita, dans Le Petit Eyo~f :
« ALLMERS. …Une résurrection, le passage à une vie plus haute.
RITA (avec un regard de désespérance). Oui, mais au prix du bonheur, de tout le bonheur de la vie.
ALLMERS. C’est un gain, Rita, que cette perte. »
Ainsi l’apaisement final – qui n’est pas celui d’un conflit intersubjectif mais celui des tensions internes aux personnages – réalise une double fusion rédemptrice. Fusion de deux êtres (Rebekka et Rosmer, l’un à l’autre : « Maintenant nous sommes un »). Fusion de l’intime – valeur interdite dans la « grande maison » – avec le cosmos.
De Rosmersbolm à Quand nous nous réveillerons, Ibsen épure sa dramaturgie. Il l’allège de toute intrigue secondaire, réduit le nombre des personnages et les entrées-sorties qui donnaient à des pièces comme Maison de poupée, Le Canard sauvage ou Hedda Gabler des allures de drame bourgeois. Coïncident enfin la pièce et l’épilogue, cette scène d’amour au seuil de la mort. Et c’est à juste titre que le vieil écrivain peut appeler Quand nous nous réveillerons…. la plus dépouillée de ses œuvres (un « échange » au sens claudélien : Rubek, l’artiste mélancolique, retrouve Irène, femme dont la vie s’est jadis arrêtée ; Maïa, son épouse, affamée des bonheurs terrestres, part avec le Chasseur d’ours, force de la nature et viveur impénitent), son épilogue dramatique. Ibsen, qui proclamait qu »‘écrire, c’est appeler sur soi le jugement dernier », livre in extremis son lever de rideau pour le jour de la Résurrection. A ce degré de jubilation et d’élévation artistique, il ne lui reste plus, à l’instar de Rubek, qu’à attendre que la mort fonde sur lui, Ce qui se produit presque immédiatement, par l’entremise d’une attaque d’apoplexie qui, tout en lui accordant six années de survie, le statufie physiquement et littérairement. Quand nous nous réveillerons… se substitue ainsi, à titre de testament littéraire, aux Mémoires que l’écrivain norvégien annonçait dans le discours de son jubilé : « un gros volume que j’ai l’intention d’écrire, un livre qui unira ma vie et ma production et en montrera l’unité ». Mais la personnalité et l’art ibséniens n’étaient-ils pas fondamentalement étrangers à ce projet d’une synthèse de la vie et de la production littéraire, à cette pratique de la « confession » ou, pour prendre un terme plus moderne, de l »‘autobiographie » qui fondera I’œuvre d’un Strindberg ?
Au vrai, l’opposition entre Ibsen et son cadet Strindberg – et, depuis, l’affrontement des ibséniens et des strindbergiens – résume l’alternative du drame au tournant du siècle dernier. Des deux dramaturges scandinaves, le premier se tourne vers le passé et achève, en une sorte d’apothéose funèbre – l’épilogue dramatique -, l’histoire de la tragédie bourgeoise que Diderot avait ouverte dans le plus grand optimisme; le second, au contraire, ne cesse d’interpeller l’avenir, d’essayer de faire table rase de la dramaturgie héritée des XVIII et XIX siècles et d’inventer des formes nouvelles. Tandis qu’Ibsen se veut un constructeur et sacrifie tout à ce « long et patient travail de construction dramatique, excitant et énervant », Strindberg s’affirme, dès Le Fils de la servante, comme un destructeur: « On le traitait volontiers, relate-t-il, de génie destructeur, car il démontait tout : jouets, montres, tout ce qui lui tombait sous la main. » Contemporains de Freud, les deux génies dramatiques accordent le rôle prépondérant aux pulsions inconscientes. Ils pressentent l’un comme l’autre que, désormais, dans le déroulement d’un drame, l’intrasubjectivité pèsera plus lourd que l’intersubjectivité. Bref, ils installent le drame dans l’intime de l’être. Mais, à partir de là, leurs chemins se séparent. Et le meilleur témoignage de cette divergence se trouve dans la lecture tendancieuse que, dans ses Vivisections, Strindberg donne de Rosmersbolm : il ne s’intéresse qu’au « meurtre psychique » que Rebecca West aurait perpétré, bien avant le lever de rideau, sur l’épouse de Rosmer ; il croit déceler une lutte mentale, un « combat des cerveaux » là où règne la foncière passivité du personnage ibsénien.
Strindberg inventera une dramaturgie de part en part subjective, un théâtre autobiographique où il impose constamment sa propre présence au milieu de ses personnages et où ces personnages ne sont que des projections et des dédoublements de lui-même. Ibsen, à l’opposé, aura été le dernier grand dramaturge à observer cette loi selon laquelle l’auteur doit complètement s’effacer devant ses personnages et rester invisible et silencieux tout au long de la pièce. Même lorsqu’il serre au plus près, à travers le personnage de Rubek, ses angoisses et sa mélancolie personnelles de grand artiste au seuil de la mort, Ibsen, homme d’un autre temps et d’une autre tradition, refuse de céder à ce théâtre à la première personne que prépare en son athanor l’alchimiste Strindberg.
NOTES
1. Peter Szondi, Théorie du drame moderne, traduit de l’allemand par Patrice Pavis, avec la collaboration de jean et Mayotte Bollack, L’Age d’homme, coll. « Théâtre-Recherche », 1983.
2. Maurice Maeterlinck, « Le Tragique quotidien », in Le Trésor des humbles, Editions Labor, Bruxelles, 1986.
3. Bernard Dort, « A la croisée des chemins », in Rosmenbolm, texte français de Terje Sinding et Bernard Dort, Editions du Théâtre national de Strasbourg, 1987. C’est ce texte de Rosmersbolm que je cite dans le présent chapitre.
4. Sigmund Freud, « Une difficulté de la psychanalyse », in Essais de psychanalyse appliquée, Idées/Gallimard, n° 353.
5. Henrik Ibsen, Un poème, cité par Terje Sinding dans son article « Strindberg, Ibsen – tours et détours de la subjectivité » in Théâtrelpublic, n° 73, consacré à Strindberg, janvier-février 1987.
 Arthur Schnitzler : le mélancolique inconstant
Arthur Schnitzler : le mélancolique inconstant