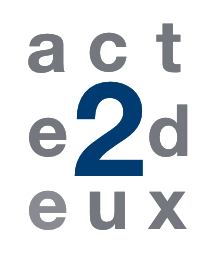ANATOLE
Arthur SchnitzlerAnatole / Arthur Schnitzler
Création à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet le 17 septembre 2003
mise en scène et traduction Claude Baqué
avec Zabou Breitman, Carlo Brandt, Jacques Denis, Laurent Bariteau
assistante mise en scène Isabelle Antoine / scénographie-lumières Matthieu Ferry / accessoires David D’Aquaro / création costumes Nathalie Lecoultre / réalisation costumes Xavier Ronze / son François Olivier / images Jacques Besse / presse Isabelle Muraour
Production L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet / Acte2Deux
Note de mise en scène / L’Éclipse du désir
Anatole est la première œuvre dramatique d’Arthur Schnitzler. Contrairement à La Ronde, plus connue, qu’il écrivit plus tard et où les scènes s’enchaînent par accouplements successifs des personnages, Anatole fut conçu comme un cycle de sept petites pièces en un acte parfaitement autonomes. Sept planètes, de tailles différentes, tournant sur elles-mêmes et irradiant chacune une lumière singulière. Aucune logique ne préside au bouquet qu’elles composent. Pourtant elles tiennent ensemble. Sans être liées, ni contenues dans un tout. Alors, comment ? Mettre en scène Anatole, c’est poser cette question : autour de quel astre gravitent ces joyeuses planètes ? Et oser cette réponse : le soleil noir du désir.
Freud fit un jour cet aveu à Schnitzler. « Je me suis souvent demandé d’où vous teniez la connaissance de tel ou tel point caché, alors que je ne l’avais acquise que par un pénible travail d’investigation, et j’en suis venu à envier l’écrivain que déjà j’admirais. »
La pièce fut publiée en 1892. Cette fin de siècle viennoise, si bien nommée « Apocalypse joyeuse » , qui vit basculer tous les domaines de l’art et de la science vers une post-modernité inquiète, est le moment et le lieu d’une faille. Anatole est ce point de raccord entre ces deux plans, un passage au trouble, au flou, une sorte de fondu enchaîné sur la scène du baiser, quand les regards déjà s’embrument. L’expression encore joyeuse de cette apocalypse dont le siècle à venir révèlera le vrai visage. L’éclipse du soleil viennois. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’ajouter une toute dernière planète au cycle des Anatole. La huitième, qui fut publiée à part, la 7 + 1. Celle qui brise le temps de l’éternel retour du même et inscrit Anatole dans une histoire, dans un après. On le retrouve, âgé, face cette Femme qui lui échappait et dont il questionnait infiniment le désir. Le moment du trop tard.
Claude Baqué – septembre 2003
Presse Anatole / Arthur Schnitzler
Extraits de presse / Anatole
« Une intelligence féroce, désespérée, mène cette plongée dans les désaccords inguérissables de l’amour et du sexe, ce voyage au bout de nos nuits, où les femmes sont finalement meilleures que les hommes. Le spectacle de Claude Baqué épouse cette intelligence avec une joie théâtrale exceptionnelle. De cette grande soirée, on sort saisi par un bonheur noir. »
Gilles Costaz, Politis – septembre 2003
« Commençons par l’essentiel : ce spectacle est un régal de tous les instants. La pièce parle de l’inconscient, le fait consister plutôt et, sans aucun souci pédagogique, décrit de façon aérienne et enjouée, un peu triste parfois (il y a du Ibsen chez Schnitzler mais aussi du Tchekhov), la malédiction de l’hystérie et de la compulsion de répétition. Anatole (Carlo Brandt, parfait) aime les femmes, les filles des faubourgs, les bourgeoises mariées, les élégantes ou les danseuses de cabaret. Évidemment, il s’ingénie à tout faire échouer pour mieux jouir de son malheur, éternelle stratégie du névrosé. »
Hervé de Saint Hilaire, Le Figaro – septembre 2008
« Ce fut sa première œuvre dramatique, publiée en 1892. Un ensemble, déjà, de petites scènes, comme « Le Ronde ». Claude Baqué, qui les a traduites et qui les met en scène, dans un décor très sobre, presque nu, en conserve la référence fin de siècle, via les costumes, en cisèle la langue, superbe, raffinée, en ralentit un peu, juste assez, le rythme, pour qu’une distanciation un rien mélancolique puisse s’installer. Et dirige un éblouissant trio de comédiens qui donnent à cet ensemble sans autre lien apparent qu’une atmosphère, celle du désir, et qu’une même vérité, celle de la difficulté d’aimer, une élégance un peu désuète étrangement fascinante. Une soirée au charme rare, un peu exigeant, dont on se souviendra comme d’une belle chose. »
Annie Coppermann, Les Échos – 25 septembre 2003
« Claude Baqué, qui a traduit la pièce, la met en scène dans un décor dépouillé et une atmosphère élégante, un brin désuète. À l’affiche, un trio d’excellents comédiens. Jacques Denis, l’ami fidèle ; sage, souvent moqueur. Carlo Brandt, que l’on n’attend pas dans ce rôle d’homme blessé, perturbé, et Zabou Breitman. Dans de ravissants costumes, elle est radieuse, mutine, enjôleuse et jalouse, pleine de charme. Mêlant mystère et séduction, chacune de ses apparitions est un vrai bonheur.
Arlette Frazer – le « choix » de Pariscope – 8 octobre 2003
« Avec cet Anatole, Claude Baqué nous donne un spectacle jubilatoire. Appuyée sur un décor épuré et des costumes élégants, sa mise en scène braque une lumière subtile sur la mécanique cruelle de Schnitzler. »
Vincent Philippe – 24 heures Lausanne – 21 octobre 2009
« Le décor, obscur et sobre, rejette l’anecdote au profit du « théâtre mental », mais les costumes ancrent la pièce dans son espace-temps, juste tension entre l’universalité d’une parole sur le désir et les déterminations culturelles du moment. Au final, une proposition théâtrale brillante. »
Pierre David – Réforme – 2 octobre 2003
« L’inconscient, le jeu subtil entre les illusions et la vérité, le reflet des images intérieures jouent un rôle considérable. Le décor tout en sobres reflets de Matthieu Ferry, qui signe aussi les très belles lumières, participe de cette volonté d’aller au-delà du miroir, au-delà des typologies faciles… Une très belle pièce, où les faux-semblants, l’hypocrisie, la jalousie et l’amour-propre montrent tout ce dont ils sont capables pour compliquer la quête du bonheur. Dans Vienne brillante mais déjà aux portes d’un autre monde. »
Agnès Santi – La Terrasse – octobre 2009
« Zabou Breitman est à elle seule un orchestre de musique de chambre. Demi-mondaine ou mondaine entière, file de joie devenue profonde, acrobate, danseuse, femme adultère, russe envahissante, chaque fois, cette comédienne exceptionnelle construit un être complet, complexe, avec ses doutes, ses contradictions, ses stratégies, ses douleurs, ses non-dits. Et, pour conclure, une bouleversante sagesse féminine, en avance sur son temps, et sur le nôtre, encore. »
Jean-Marc Striker – France-Inter – 21 septembre 2008
« Belle scénographie de Matthieu Ferry, dont chaque changement de tableau évoque un cadre de Klimt, atmosphère fin de siècle, cet Anatole, rarement joué, vaut par son élégance mélancolique. »
Annie Chenieux – Le Journal du Dimanche – 28 septembre 2003
« Filant les traces d’une ronde de personnages pris dans un entrelacs d’imbroglios sentimentaux, Anatole fait constamment émerger le léger tremblement des choses et des êtres, les troubles d’une impossible union du féminin et du masculin. Claude Baqué capte ce bouillonnement de vie à la volée de scènes superbement agencées : avec un sens remarquable des temps et des contretemps et de l’agencement dramatique, le metteur en scène nous fait découvrir peu à peu l’écheveau des désirs, des doutes qui les unissent, de petites trahisons et manipulations qui les désunissent. Grandes qualités esthétiques (lumière et décor de Matthieu Ferry), aphorismes caustiques, texte brillant sculpté à l’ébauchoir : le spectacle appelle tous nos bis. »
Myriem Hajoui – A nous Paris – 27 octobre 2003
« Une intelligence féroce, désespérée, mène cette plongée dans les désaccords inguérissables de l’amour et du sexe, ce voyage au bout de nos nuits, où les femmes sont finalement meilleures que les hommes. Le spectacle de Claude Baqué épouse cette intelligence avec une joie théâtrale exceptionnelle… De cette grande soirée, on sort saisi par un bonheur noir. » Voir l’article
Gilles Costaz, Politis – septembre 2003
Autour d’Anatole / Arthur Schnitzler
Article / Le Mélancolique Inconstant, de Françoise Decant
 Arthur Schnitzler : le mélancolique inconstant
Arthur Schnitzler : le mélancolique inconstant
Fantasme de séduction et répétition
Françoise Decant
[La Clinique lacanienne – octobre 2011]
Freud admirait beaucoup Arthur Schnitzler. Dans la longue lettre qu’il lui adressa en 1922, à l’occasion de ses 60 ans, peut se lire certes l’admiration de Freud, mais aussi ce qu’il avait eu l’occasion déjà d’énoncer auparavant – à savoir le fait que l’artiste précède le psychanalyste.
« Je vais vous faire un aveu… Je pense que je vous ai évité par une sorte de crainte de rencontrer mon double… En me plongeant dans vos splendides créations, j’ai toujours cru y trouver, derrière l’apparence poétique, les hypothèses, les intérêts et les résultats que je savais être les miens. Votre sensibilité aux vérités de l’inconscient, de la nature pulsionnelle de l’homme, l’arrêt de vos pensées sur la polarité de l’amour et de la mort, tout cela éveillait en moi un étrange sentiment de familiarité. (Dans un petit livre écrit en 1920, Au-delà du principe du plaisir, j’ai essayé de montrer qu’Éros et la Pulsion de mort sont les forces originaires dont le jeu opposé domine toutes les énigmes de l’existence.) J’ai ainsi eu l’impression que vous saviez intuitivement – ou plutôt par suite d’une auto-observation subtile – tout ce que j’ai découvert à l’aide d’un laborieux travail pratiqué sur autrui[1]… »
Si l’œuvre de Schnitzler, encore mal connue de nos jours, est une formidable invitation à revenir à Vienne, dans cette Vienne fin de siècle, où naquit la psychanalyse et qui fut aussi le creuset de tant de richesses culturelles, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à la question de ce que Freud appelle dans sa lettre la polarité de l’amour et de la pulsion de mort dépliée dans le fantasme de séduction, telle que Schnitzler nous la donne à lire dans deux de ses œuvres, Anatole et Le retour de Casanova, et ce à partir d’un énoncé qui a fait énigme pour nous : il s’agit du « mélancolique inconstant ».
Mais tout d’abord, quelques mots concernant l’écrivain autrichien.
Étrange destin que celui d’Arthur Schnitzler qui, après avoir fait médecine et ouvert son cabinet, se consacra à sa passion : écrire. Il faut dire que cette passion s’empara très tôt de lui, car à l’âge de 13 ans, il avait déjà composé une bonne vingtaine de pièces de théâtre. Son invincible besoin d’écrire, pour reprendre ses propres termes, lui valut la publication d’une œuvre immense, à savoir aujourd’hui trente-cinq pièces de théâtre et cinquante-huit récits (nouvelles ou romans).
Schnitzler est né en 1862, mort en 1931. Fils d’un médecin renommé, professeur à l’Université, chef de service de laryngo-logie qui soignait les cordes vocales des stars de l’opéra et des acteurs de théâtre connus en utilisant l’hypnose, Arthur Schnitzler obtint son doctorat en 1885. Quatre,ans plus tard, il publia un article dans une revue scientifique, sur « L’aphonie fonctionnelle et son traitement par l’hypnose et la suggestion » qui visait à montrer comment appliquer la technique de Bernheim à la laryngologie.
En 1892, soit trois ans avant la publication des Études sur l’hystérie de Freud et Breuer, Schnitzler écrit Anatole, une pièce de théâtre[2] composée de plusieurs saynètes, dont l’une d’entre elles, «Question fatale», traite de la question de la vérité, une vérité qui ne peut se dire toute, même sous hypnose.
Cette question de la vérité, du mensonge et de la tromperie, question qui ne manque pas de renvoyer au dispositif analytique et au transfert, on la retrouve bien plus tard, mais sous une autre forme, lorsqu’en 1915, à 53 ans, Schnitzler se met à écrire son autobiographie relatant ses années de jeunesse (« Une jeunesse viennoise »).
Schnitzler se remémore, mais cette remémoration qui veut dire le vrai d’une histoire[3] n’a rien à voir avec la façon dont Schnitzler traite de la question de la vérité, la vérité du discours du sujet dans cette saynète intitulée « Question fatale ».
Dans les mémoires, on peut dire que l’Autre scène a quitté la scène… Par contre, avec Anatole, une place de choix lui est réservée, avec en particulier, l’équivoque, l’énigme sans cesse reconduite, la dualité, le paradoxe, l’inattendu, la vérité au-delà.
Le mélancolique inconstant
Anatole est un grand séducteur viennois, dont Schnitzler décrit les démêlés amoureux avec beaucoup d’humour, de légèreté, de subtilité et d’élégance : un vrai bijou.
Mais pourquoi Anatole éprouve-t-il le besoin de se qualifier de « Mélancolique inconstant », lorsque Gabrielle, sa maîtresse, lui demande à quelle classe d’hommes il appartient ?
Inconstant, certes, il l’est, ce séducteur qui collectionne les plus belles femmes, les petites grisettes[4], mais aussi les mondaines mariées qui le rejettent, et qui ne fait que voler d’une aventure à une autre, pour ne pas dire d’une déconvenue à une autre…, mais pourquoi se désignerait-il comme étant le Mélancolique ? Ne serait-ce pas ce que Schnitzler a trouvé de plus vrai pour designer le lien de l’amour et de la mort, mais aussi le lien de la répétition à la pulsion de mort, ce que Freud appellera plus tard la contrainte à la répétition : Wiederholungzwang. C’est bien sûr une hypothèse, mais une hypothèse que nous avons trouvée digne d’intérêt lorsque nous avons constaté en voyageant dans l’œuvre de Schnitzler, qu’il avait intitulé, un an après Anatole, son premier roman : Mourir[5], roman écrit sous l’emprise d’une sorte de nécessité et achevé de nuit sur une table de café…
Nous savons que c’est en 1914, avec son article « Remémo-ration, répétition et perlaboration », que Freud a commencé à conceptualiser la notion de répétition, mais ce n’est que six ans plus tard, en 1920, qu’il va proposer une nouvelle élaboration de l’appareil psychique en introduisant, avec l’idée d’un au-delà du principe du plaisir, la notion essentielle de pulsion de mort.
Entre-temps, cette question de la répétition n’a cessé de le travailler, en témoignent les petits essais qui ont été regroupés et publiés dans L’inquiétante étrangeté. La névrose d’échec est interrogée par le biais littéraire, que ce soit avec Macbeth de Shakespeare ou Rebecca – l’héroïne de Rosmersholm, la pièce d’Henrik Ibsen, qui refuse ce qu’elle avait le plus désiré -, mais en relisant ces petits essais, nous nous sommes aperçus que Freud, qui insistait tant pour rappeler l’abandon de l’hypnose dans « Remé-moration, répétition et perlaboration », n’avait pas pour autant mis de côté son frère jumeau, Thanatos, et lui avait réservé une place de choix dans son essai « Le choix des trois coffrets », qui date de 1913. C’est une façon de dire que la pulsion de mort n’est pas tombée comme ça en 1920 dans la théorie psychanalytique.
Du fait d’une inversion – la mort est remplacée par la jeune fille la plus belle, que ce soit dans la mythologie ou bien dans la dramaturgie -, L’homme surmonte la mort qu’il a reconnue dans sa pensée, nous dit Freud qui ajoute alors : « On choisit là où, en réalité, on obéit à la contrainte, et celle qu’on choisit n’est pas la plus terrifiante, mais la plus belle et la plus désirable. »
La répétition : répétition d’un échec
Anatole est un homme à femmes et il sait ce que séduire veut dire. Chacune des saynètes met en scène le fait que cela ne marche pas, que cela ne colle pas, soit parce que les femmes qu’il aime sont mariées, ou bien que les gentilles grisettes lui sont infidèles ou le fatiguent.
« Qu’est ce que le sujet cherche à répéter à son insu dans des situations qui ne sont pas nécessairement une source de plaisir ? », se demande Freud avant d’admettre « qu’il existe dans la vie psychique une tendance irrésistible à la reproduction, tendance qui s’affirme sans tenir compte du principe du plaisir, en se mettant au-dessus de lui ». Après avoir évoqué les patients qui ont l’impression d’être poursuivis par le sort, il nous dit en 1920 dans le chapitre « Principe du plaisir et transfert affectif » : « On connaît des amoureux dont l’attitude sentimentale à l’égard des femmes traverse toujours les mêmes phases et aboutit au même résultat » avant de parler du « retour éternel du même » et de la contrainte à la répétition, la Wiederholungzwang.
Grâce aux découvertes freudiennes, la psychanalyse renverse la croyance communément admise qui fait du séducteur, de l’homme à femmes, quelqu’un dont la recherche du plaisir ne serait soumise à aucune loi interne.
La répétition n’est pas répétition d’une satisfaction, elle est répétition d’une déception. Si rencontre il y a, ce ne peut être que rencontre manquée, rencontre manquée avec un réel qui se dérobe mais qui insiste et revient toujours à la même place, et qui se présente dans le champ de la psychanalyse sous la forme du traumatisme, c’est-à-dire de quelque chose de tout à fait inassimilable. Et c’est pour cela que le sujet va tisser le fantasme, pour masquer ce réel traumatisant, qui pourtant commande toutes nos activités. Or, « la place du réel, qui va du trauma au fantasme – en tant que le fantasme n’est jamais que l’écran qui dissimule quelque chose de tout à fait premier, est déterminante dans la fonction de la répétition » comme nous le rappelle Lacan en introduisant la question de la répétition dans le séminaire sur Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse.
Dans Qu’est-ce que le réel ?, Gérard Pommier montre, à propos de la répétition de la rencontre amoureuse, comment l’inceste, qui est un des noms du réel, abrité derrière le fantasme, risque de pointer le nez lorsque le fantasme se réalise. Ainsi, le réel est tenu à distance par le fantasme d’un amour à venir qui n’est pas encore réalisé mais cherche à l’être. De sorte que le rêve d’un amour parfait est plus grand que l’amour présent et il anime ce qu’il y a d’inépuisable et de violent dans la quête amoureuse.
Cette violence peut s’entendre dans la saynète intitulée « Épisode », dans un passage où la position subjective du héros de Schnitzler est savamment dépliée dans toute sa complexité.
Anatole : « Il n’y a rien d’autre à raconter, au fond… Je la connais donc depuis deux heures, je sais qu’après cette soirée, je ne la reverrai probablement jamais – c’est elle qui me l’a dit – et pourtant je sens qu’à cet instant je suis aimé à la folie. Ce qui me pénètre tout entier – dans l’air alentour, notre ivresse exhale une senteur d’amour… Et puis m’est revenue cette formule ridicule et sublime : ma pauvre-pauvre enfant ! Le caractère épisodique de l’histoire m’est alors apparu en toute clarté. Et tandis que je sentais le souffle brûlant de C’était déjà du passé, en fait. Elle avait été l’une de celles que j’avais piétinées. Le mot a surgi en moi, ce mot aride : épisode. Et en même temps, j’étais moi-même comme hors du temps… »
Pris dans un présent qui signe son arrêt de mort du fait de ce trop grand amour qui l’envahit, le pénètre de toutes parts, Anatole est effectivement hors du temps et ce, jusqu’à l’arrivée – venue d’ailleurs – de cette formule à la fois ridicule et sublime, qui s’impose à son esprit, nous dit-on… Peut-on y voir ce que Lacan a appelé l’automaton, l’insistance des signes derrière laquelle gît le réel[7] ? C’est bien sûr une question. En tout cas, c’est ensuite à un véritable tissage de la réalité psychique que nous assistons, avec le retournement de la pulsion de mort en pulsion meurtrière, projetant le sujet sur la scène du futur en y installant un nouvel amour.
À la place d’une formule a surgi un signifiant « Episode » tissé dans les mailles du fantasme.
Mais n’est-ce pas à propos de la contrainte, Zwang, de la Wiederholung qui commande les détours mêmes du processus primaire, que Lacan mentionne l’emprunt de Freud à Fechner concernant ce lieu intemporel, cette autre localité, cette Autre scène ?
Fraçoise Decant
[1] 1. S. Freud, Correspondance, 1873-1939, Paris, Gallimard, 1979.
[2] A.Schnitzler, Anatole, Arles, Actes sud papiers, 1992. Anatole fut présenté au théâtre Athénée Louis Jouvet en 2003 dans une mise en scène de Claude Baqué.
[3] Malgré l’intérêt qu’on peut trouver à lire cette autobiographie, il est néanmoins difficile d’y voir une œuvre…
[4] Süsse madden dans le texte. Ce sont les filles des faubourgs, les actrices… Bref, le petit monde de l’époque.
[5] 5A. Schnitzler, « Mourir », dans Romans et nouvelles, tome I, Paris, La Pocho-thèque, 1996.
[6] Souligné par nous.
[7] Lacan parle de « l’insistance des signes à quoi nous nous voyons commandés par le principe de plaisir » dans Le Séminaire, Livre XI (1963-1964), Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973.