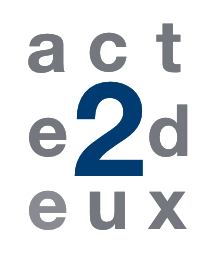De la Transubstantiation dramatique
De la Transubstantiation dramatique
Article de Jules de Gaultier dans La Revue blanche (1889-1903)
(…) Voici une pièce qui renferme, outre les éléments primordiaux constitutifs de tout drame d’Ibsen, un exemple de cette sorte : La Dame de la Mer.
Evoluant au premier plan du drame, c’est l’intrigue que l’on connaît : les fiançailles d’Ellida avec un marin, personnage dont on sait à peine tout d’abord s’il est réel, mais qui exerce sur la jeune fille un étrange pouvoir. Puis, le mariage d’Ellida avec le Dr Wangel, ses vains efforts pour se soustraire à la tyrannie du souvenir, sa maladie de langueur, les lettres de Johnston qui, bien qu’averti du mariage de sa fiancée, semble l’ignorer et promet toujours de venir la prendre, l’attente anxieuse de la jeune femme, dominée par une fascination irrésistible; enfin l’apparition de l’homme derrière la haie du jardin et le débat final qui se formule pour le spectateur de curiosité rudimentaire en cette alternative : Ellida va-t-elle suivre Johnston, son premier fiancé, ou va-t-elle demeurer auprès du Docteur Wangel, son mari ? Mais en ce dernier acte, Johnston déjà n’est plus Johnston : par l’apparence à moitié réelle et à moitié fantastique qu’il lui a prêtée, Ibsen a posé sa valeur de symbole, il l’a signalé comme le facteur idéologique de son drame. En effet, de la signification qui sera attribuée à son personnage, va suivre l’interprétation de la pièce toute entière. Or, cette signification est ici, d’une part, merveilleusement large et indéterminée, – en sorte qu’elle ménage à l’esprit du spectateur toute libre initiative, – et, en même temps, elle est précisée presque grossièrement en vue du développement idéologique dont l’exemple particulier est joint. Le fiancé d’Ellida, qui a nom Johnston au premier acte, lorsqu’il matérialise le rêve sentimental de la jeune fille, devient ensuite l’Américain, puis l’Etranger; il est tantôt celui-ci et tantôt celui-là, comme s’il pouvait prendre l’infinité de toutes les formes de la vie. Mais il se nomme aussi Frimann, et cette dénomination évoque d’une façon transparente la thèse de liberté qu’Ibsen développe dans sa pièce, thèse exprimée au dernier acte lorsqu’Ellida, hésitante, entre les deux hommes, choisit spontanément Wangel dès qu’elle est libre de choisir.
Ainsi, dans cette dernière scène qui dénoue l’intrigue sentimentale, la pièce philosophique apparaît. – « Oui, oui, je vous assure, madame Wangel, que nous nous acclimatons. – Oui, monsieur Ballested, pourvu que nous soyions libres – Et responsables, ma chère Ellida », ajoute Wangel. – « Et responsables, tu as raison », acquiesce Ellida. La responsabilité morale a donc pour condition la liberté absolue dont elle est le corrélatif. Tout individu porte en lui une tendance intérieure qui constitue sa personnalité, qui est, à vrai dire, sa réalité essentielle. Tant que cette tendance ne peut s’exercer librement, la réalité individuelle est abolie, elle est inexistante, en sorte que l’individu, n’étant pas, ne saurait être responsable d’actes dont il n’est pas, à vrai dire, l’auteur.
Au moyen de cet énoncé philosophique, voici le rôle de Frimann précisé. Il est matérialisé pour les besoins de la représentation théâtrale, l’élément personnel irréductible qui est en chaque être, et qui, contrarié par quelque circonstance, par quelque décision prise à son encontre, élève la réclamation de son droit contre le dommage qu’il a subi. Ainsi d’un ressort comprimé par une force étrangère et dont toute l’énergie est tendue à se redresser. À quel point Ibsen est parvenu à différencier l’objet de sa représentation de l’élément dont il se sert pour le figurer, on le voit d’après cet exemple. L’étranger devient ici le signe concret d’une entité abstraite. Une valeur autre que celle qu’il figure extérieurement lui a été attachée : désormais à chacun de ses mouvements extérieurs va correspondre un déplacement de l’idée qu’il signifie. De plus, tous les autres personnages du drame, pour se mettre d’accord avec la valeur symbolique de ce personnage clairement exprimée par l’auteur, vont être tenus de signifier eux-mêmes quelque aspect particulier de l’idée en scène, en sorte qu’au moyen de cette clef qui nous ouvre la signification algébrique de tous les figurants, pris comme des signes concrets, une pièce nouvelle et purement idéologique va se jouer devant nous.
Voici trois femmes pourvues de personnalités plus ou moins fortes. L’Etranger tient lieu de commune mesure entre elles. Il représente pour chacune, en opposition avec le réel, tout le possible et il extériorise aussi l’énergie, avec son degré précis, de la tendance intérieure qui constitue leur individualité distincte. Son pouvoir va donc grandir en raison de la violence de chaque personnage. – Wangel représente, pour Ellida, la contrainte d’une réalité trop étroite, qui, limitant l’horizon de la jeune fille, excluant tout le possible, semble supprimer le choix. Car Ellida a vécu dans l’isolement du phare, loin du contact multiple des réalités. Elle est de plus une individualité puissante, une force qui refuse de s’exercer si elle n’est pas assurée de suivre sa loi. Ces deux conditions réunies autour d’elle et en elle-même, et qui fondent le pouvoir de l’Etranger sur un être, justifient la violence dramatique de sa longue hésitation.
Bolette avec Arnholm reproduit avec une intensité amoindrie le même conflit. La maison où elle vit retirée, près de l’étang des carassins, a pour elle la même signification symbolique que pour Ellida le phare solitaire. Pourtant la vie, avec ses figurants, longe la haie qui borde le jardin et Bolette est d’ailleurs d’individualité moins puissante que la Dame de la mer. On sent en elle une malléabilité de nature capable de se prêter à plusieurs adaptations et, de fait, sans crise douloureuse, après un bref sursis, elle accepte de limiter à Arnholm son désir d’inconnu.
Il en est bien autrement de la petite Hilde vis-à-vis de Lyngstrand. Hilde représente un degré d’énergie tout à fait supérieur. Incapable de sacrifier quelque part de sa personnalité ni par faiblesse ni par bonté, elle est indemne de nos vertus comme de nos vices. Son charme procède de cette indépendance et de ce qu’une nouveauté irréductible est en elle. Lyngstrand a demandé à Bolette de lui consacrer une pensée chaque jour quand il sera parti, afin que son art en profite, et déjà il suppute qu’Hilde, devenue plus grande, pourra remplir vis-à-vis de lui le même office. Mais la petite Hilde n’accepte pas de subordonner son existence à une autre existence. Et c’est elle qui railleusement assigne à Lyngstrand un rôle sacrifié dans le décor de sa vie. « Croyez-vous, lui demande-t-elle, que cela m’ira bien d’être tout en noir? » Et comme l’artiste imagine d’elle un délicieux portrait, « une jeune veuve en grand deuil », elle rectifie: « une jeune fiancée en deuil».
En contraste avec Ellida et bien au-dessous de Bolette, l’étonnant Ballested bouffonne sur les tréteaux comme un clown entre deux exercices. L’Etranger n’a qu’un bien faible empire sur Ballested. Ballested est sourd à ses revendications. Mais il supplée la liberté de choisir sa vie par une souplesse infinie à s’accommoder de toutes les circonstances. D’individualité amorphe, il est prêt toujours à s’accli, à s’acclimater sur quelque sol que le hasard le transporte. Pour noter en lui cette absence de personnalité, Ibsen lui attribue toutes les professions. Épave d’une troupe de comédiens dispersée après faillite, c’est lui qui, au premier acte, en qualité de factotum, hisse le pavillon chez les Wangel en l’honneur de l’arrivée d’Arnholm. En même temps, il brosse une toile disposée sur un chevalet et se sauve précipitamment en voyant arriver le bateau sur le fjord, car il va offrir ses services aux passagers : il est coiffeur, maître de danse, et le voici, au deuxième acte, guidant les touristes vers le point de vue. Ballested « ne marche pas par paire» comme Ellida avec Wangel, Bolette avec Arnholm, Hilde avec Lyngstrand. Il est seul, et non sans intention de l’auteur, qui sollicite ainsi l’esprit du spectateur à chercher, en dehors de la thèse matrimoniale qu’il développe, une application plus ample de l’idée de liberté et des symboles qu’il a construits.
En dehors de l’intrigue fantastique, en dehors de la pièce à thèse qui paraît prendre parti pour une émancipation de la jeune fille et s’adresse aux sociologues, il y a en effet dans la Dame de la mer une troisième pièce faite pour passionner une nouvelle catégorie d’esprits, et cette troisième pièce est, à vrai dire, la seule et véritable, dont les deux autres ne sont, en quelque sorte, que le moyen; pièce multiple d’ailleurs qui s’élève avec l’intelligence plus haute de chaque spectateur et selon l’idée maîtresse qui, plus ou moins suggérée par l’auteur, devient le thème et le coefficient du nouveau drame idéologique.
Ce qu’il nous faut donc considérer comme essentiel dans le drame d’Ibsen, c’est cela seulement qui rend possible cette troisième et multiple pièce.
Et cette pièce est possible dès qu’un système précis de relations est établi entre les différents personnages, tel qu’on vient de le voir fixé entre les personnages de la Dame de la mer, Ellida, Bolette, Hilde, Ballested qui s’ordonnnent tous vis-à-vis de l’Etranger selon une hiérarchie rigoureuse et en quelque sorte numérique: car dans son rapport avec lui, chacun d’eux pourrait être représenté par un chiffre. L’ensemble de ces chiffres séparés les uns des autres par des intervalles inviolables, qui paradoxalement les joignent en un organisme, cet ensemble forme le premier terme d’une proportion : plus ou moins touffu, plus ou moins chargé d’incidences, il a une physionomie personnelle et distincte. Or on sait que cette république de nombres ne sera pas désagrégée quant aux rapports entre eux de chacun de ses éléments, si l’on applique à chacun d’eux un même numérateur. Ce numérateur est ici le facteur idéologique, c’est-à-dire l’idée qui transforme la signification soit d’un fait, soit d’un personnage, – comme c’est le cas pour l’Étranger dans la Dame de la mer – et par là transpose l’aventure toute entière. Ce facteur idéologique est un élément essentiel de la représentation. Il en est le levier. L’auteur n’est pas tenu de préciser sa signification, comme il l’a fait sur un point dans la Dame de la mer; mais il doit nous faire sentir que ce facteur existe et qu’il veut être appliqué, le spectateur demeurant libre de l’imaginer, de tirer de la substance de son cerveau le motif an moyen duquel féconder le drame. Constatons d’ailleurs qu’au lieu d’un facteur idéologique, Ibsen a coutume d’en désigner plusieurs, que des allusions plus ou moins transparentes signalent. Il indique à l’investigation des chercheurs plusieurs pistes où l’herbe plus ou moins foulée laisse entrevoir ou dissimule la ligne brune du sentier. Les esprits avertis et rompus déjà à la gymnastique des idées préféreront sans doute, parmi les pièces de son théâtre, celles où une semblable désignation est plus obscure, celles en même temps, dont Solness le Constructeur réalise le type, qui, allégées de toute explication, sont réduites aux éléments essentiels de la suggestion dramatique : une aventure si bien liée dans toutes ses parties qu’elle est une forme merveilleuse où couler toute idée, une aventure d’intérêt si puéril, que l’allusion la plus légère ou la plus lointaine suffit à la transposer. A d’autres esprits un apprentissage est nécessaire : c’est pour ceux-ci qu’Ibsen ajoute parfois à l’exposé de l’aventure un développement idéologique. C’est à eux qu’est dédié le thème matrimonial de la Dame de la Mer exprimé de façon transparente par le jeu des trois couples et fait pour accoutumer les néophytes à déchiffrer sous les faits les attitudes de l’idée. Ce thème ne constitue pas au même titre que le facteur idéologique un élément essentiel du drame.- il peut être retranché et, de fait, il n’apparaît pas dans certaines pièces. Dans la Dame de la Mer, Ibsen l’a utilisé à préciser la relation numérique des personnages entre eux, mais cette relation eût pu être établie, comme dans Solness, par les contingences du scénario et, exhaussée par le symbole, elle eût suscité le drame idéologique dont elle est la figuration concrète.
Le théâtre d’Ibsen, comme toute œuvre d’art véridique, dote l’esprit, dans le même temps, d’une liberté sans limite et d’une méthode rigoureuse. Ainsi le spectateur est libre de varier à l’infini le développement idéologique contenu dans cette Dame de la Mer qui vient d’être analysée : mais sitôt qu’il a attaché à l’Etranger un sens nouveau, la relation instituée par Ibsen entre tous ses personnages va nécessiter la signification de chacun d’eux, en rapport avec l’idée nouvellement élue. Car des intervalles comme musicaux séparent tous ces personnages, les situant les uns vis-à-vis des autres, et il en est de même des circonstances de la pièce qui, si puériles qu’elles apparaissent parfois, n’en sont pas moins coordonnées entre elles selon un ordre strict. Tout cet arrangement forme un appareil précis et conditionne rigoureusement le développement du thème nouveau. Des intelligences diverses sauront faire tenir dans cet appareil des éléments dissemblables; mais ces éléments une fois donnés s’amalgameront entre eux selon des lois fixes, s’opposeront et se concilieront au même endroit du drame que les personnages eux-mêmes qui les signifient, avec des degrés égaux dans la violence, et selon des correspondances inflexibles. Ainsi le même air, posé tour à tour sur des paroles profanes ou sacrées, évoque dans l’esprit une succession d’images différentes, selon une progression passionnelle identique. A entendre le drame ainsi transposé par le motif personnel qu’il y a fait tenir, le spectateur goûte la joie de considérer son idée se mouvoir et vivre selon chacune des péripéties de l’aventure, évoluer et progresser avec les gestes de la petite Hilde, et avec le débat de la Dame de la Mer, sa distinguer et se préciser par le contraste des propos, de Ballested, par les conversations de Bolette avec Arnholm. Tous ces personnages, avec leurs mouvements et leurs paroles visibles, vont évoquer pour lui un drame abstrait, composé d’attitudes cérébrales invisibles et fait à la ressemblance de l’intrigue concrète qui se joue sur les tréteaux. Entre les deux pièces, l’identité d’apparences résultera de ce qu’un même système de grandeurs proportionnelles imposera sa forme à l’une et à l’autre.
Ainsi ce qu’il convient d’admirer d’abord chez Ibsen c’est, en dehors de toute valeur immédiatement intelligible et avant toute application, la beauté architectonique de l’œuvre, le balancement harmonieux (les lignes qui la composent, la symétrie des proportions, la pure mathématique des grandeurs. Car c’est tout cet ensemble qui compose le merveilleux appareil de transposition qui est la création propre de l’artiste: une forme aux contours précis, mais vide, en sorte que tous les intellects y peuvent librement apporter des substances nouvelles. A cette beauté purement formelle, l’œuvre d’art emprunte son pouvoir de s’affranchir du temps : ses proportions sont telles qu’elle peut abriter des intelligences futures, riches de notions inconnues à l’époque de sa formation. D’où parfois son caractère d’apparence prophétique. Une phrase bien faite, par la seule vertu de sa construction, voit sa signification s’approfondir et se multiplier à travers la durée avec le progrès de la connaissance. C’est pourquoi, si vaste que l’on suppose l’intelligence d’un artiste, son œuvre s’élève, au point de vue de ce qu’elle embrasse, bien au-dessus de cette intelligence même. Elle tire sa valeur absolue non pas des concepts eux-mêmes que l’artiste y a inclus, mais de toute la hauteur dont elle domine ces concepts, de toute l’ouverture par où elle offre accès à de nouvelles idées. Son titre authentique est d’être une forme inaltérable. Par là l’œuvre d’art essentielle reproduit le phénomène de la vie qui, à travers l’écoulement indéfini de la substance, maintient, dans une rigidité, des formes pareilles. L’artiste qui crée, en vertu d’un don, une forme intellectuelle, – par la méthode insérée dans son œuvre et qui s’impose à tous les intellects se penchant sur elle, – s’associe tout effort, revendique tout apport idéologique du temps actuel et futur.
Parmi ces appareils de rêve et de mentalité que sont les œuvres d’art, le théâtre d’Ibsen est, entre tous, d’une extraordinaire perfection. On va en faire usage ici pour dégager, en toute indépendance, de la Dame de la Mer d’abord, puis de l’œuvre dramatique tout entier, l’un des aspects de cette troisième pièce invisible et multiple dont l’intrigue apparente, avec toute sa délicate ingéniosité et son charme souvent incomparable, est le signe et le moyen. On profitera de la liberté d’interprétation plénière, que laisse à chaque esprit l’œuvre d’art, pour insérer dans le magique appareil une idée de choix personnel, confiant dans la perfection du subtil mécanisme pour conférer à cette idée sa forme et la revêtir de prestige. Ainsi d’un mangeur d’opium qui se contente d’assurer à son demi-sommeil 1’audition de quelque phrase mélodique préférée et se fie à la bonté du poison pour développer en symphonie ce thème chétif. En cette troisième pièce, le fait essentiel d’une transsubstantiation va donc se manifester avec évidence, car chaque geste, chaque parole, chaque acte et chaque circonstance apparaîtront dépouillés de leur intérêt immédiat, pour n’être plus que les signes concrets qui, à la ressemblance d’une apparence naturelle, représenteront des apparences abstraites évoquées selon le gré d’une volonté particulière..
 CHOIX D’UN FACTEUR IDÉOLOGIQUE (L’Evolution)
CHOIX D’UN FACTEUR IDÉOLOGIQUE (L’Evolution)
Le levier dont on fera usage ici pour transposer le théâtre d’Ibsen est l’idée d’évolution. Sous ce mot, il faut comprendre l’ensemble des attitudes adoptées par la Vie pour se manifester et pour durer. Ecartée l’idée inaccessible d’une création et d’une fin, quelle est la loi dit devenir ? Cette interrogation se décompose en deux autres –
Comment le présent maintient-il les acquisitions du passé c’est-à-dire : Quel est le mode conservateur de la vie ?
Comment l’avenir parvient-il à se différencier du présent C’est-à-dire : Quelle est la loi du changement ?
Une telle question est d’une extrême généralité, car elle embrasse le monde moral aussi bien que le monde physique. Et comme celui-ci, si obscur qu’il soit, se manifeste pourtant à nos yeux avec plus de sincérité que le monde moral, c’est aux sciences physiologiques qu’il convient de demander l’hypothèse dont la formule vaudra ensuite pour régir les phénomènes du inonde moral.
L’art d’une époque. comme l’eau reflète les vols d’oiseaux qui la dominent, reflète les idées qui durant cette même époque ont traversé les cervelles humaines. Aussi, n’y a-t-il pas matière à s’étonner si l’œuvre dramatique d’Ibsen reproduit un ordre de préoccupations qui a tenu tout le siècle attentif.
D’ailleurs, parmi toutes les pièces de son théâtre, la Dame de la mer est la seule qui trahisse par des allusions directes ce souci scientifique. Ballested, peintre symboliste à l’occasion, explique à Lyngstrand le sujet de son tableau : au fond d’un fjord, sur un récif, une sirène mourante; elle agonise dans cette eau saumâtre « parce qu’elle s’est égarée et ne sait plus retrouver le chemin de la mer». La nostalgie d’Ellida, exilée aussi des rivages marins, commente ce symbole par un nouveau symbole. Mais dans une conversation avec Arnholm, Mme Wangel précise l’hypothèse. « Nous n’appartenons pas à la terre ferme? » demande Arnholm. « Non. Je crois que si nous nous étions accoutumés, dès notre naissance à vivre sur mer, dans la mer même, nous serions peut-être beaucoup, beaucoup plus parfaits que nous ne le sommes. » Et elle pense que les hommes ont fait fausse route en devenant des animaux terrestres au lieu de devenir des animaux marins ». Le personnage d’Ellida hésitante entre Friman et Wangel, entre deux états différents de la vie, symbolise, à travers le vertige des siècles, vers quelque date géologique imprécise, l’épisode le plus poignant de la légende scientifique, la métamorphose de l’animalité marine en une animalité terrestre. La vie, enclose jusque là comme un embryon dans l’œuf marin, voit son enveloppe brisée; elle apparaît sur le limon terrestre, dans un milieu hostile, nue parmi l’atmosphère qui la touche et la baigne. Va-t-elle s’adapter à ces conditions nouvelles ? Va-t-elle mourir? La Dame de la Mer parviendra-t-elle à s’acclami, à s’acclimater ? Oui pourvu qu’elle soit libre, c’est-à-dire, dans la langue des lois physiques, pourvu que spontanément un changement s’accomplisse en elle qui la dote d’un organisme en harmonie avec les conditions du nouveau milieu. Or le changement s’accomplit. Wangel résilie le marché, le contrat qui les liait l’un à l’autre. « Maintenant, choisis ta route. Tu es libre, complètement libre », et aussitôt à l’Etranger qui l’appelle: « Entends-tu Ellida ! On sonne maintenant pour la dernière fois. Viens donc! » Ellida répond
d’une voix forte : « Jamais je ne vous suivrai après ce qui vient de se passer. » Après la longue crise douloureuse la métamorphose vient de se réaliser soudain. Ellida avec des poumons dilatés va pouvoir respirer maintenant parmi l’atmosphère qui l’environne.
Cet exode de l’animalité marine vers l’existence terrestre apparaît la grande crise de puberté de la vie organique, et, aux approches de la métamorphose, c’est l’effroi d’une agonie que traduit l’angoisse d’Ellida. Avant cet exode, c’est, dans le milieu marin, l’enfance de la vie : des formes s’ébauchent, s’essaient en des avatars sans fin et jamais ne s’achèvent. C’est une souplesse sans limite à revêtir toutes les apparences, a se diversifier à l’infini. C’est aussi une indépendance, un besoin nomade, un instinct de liberté qui ne se complaisent qu’en ce perpétuel changement, qui ne sauraient s’astreindre à se figer en quelque aspect particulier.
Mais avec l’avènement de la Vie sur la surface terrestre, une loi de fixité succède à cette loi de changement. Des formes déterminées apparaissent et persistent. Une différenciation de milieu aussi complète, qui commandait un remaniement profond du plan organique, a épuisé la virtualité des êtres et leur a imposé sans doute des caractères spécifiques désormais peu modifiables, – en déterminant leurs formes, a aboli leur pouvoir d’en prendre par la suite de nouvelles.
L’Etranger représente vis-à-vis d’Ellida la virtualité première de la Vie, cette faculté protéique à laquelle elle va renoncer pour l’avenir en l’exerçant une fois pour toutes et, lui remémorant tout le poème des possibles, il la fait hésiter longtemps sur le seuil de sa décision. « La décision ! La décision irrévocable à jamais » s’écrie-t-elle avec désespoir, alors qu’il la somme de choisir librement entre Wangel et lui.
Aussi, tandis que dans la pièce concrète l’Etranger demeure pour Ellida le fiancé, l’irréalisé, le rêve , Wangel est le mari, – c’est-à-dire la réalisation et en même temps la borne du rêve. Ellida, qui appartient désormais à Wangel s’interdit toutes autres aspirations. Sa vie, dans le présent et dans l’avenir, est définie; il n’est plus que de maintenir les termes du contrat, de perpétuer à travers les années l’ensemble de sentiments et de devoirs dont la formule idéale vient d’être posée.
Au point de vue symbolisé de l’évolution, l’Etranger représente, en un lieu inconnu de l’Espace et du Temps, la variabilité de la Vie organique, la jeunesse de la vie, sa virtualité, son pouvoir d’évoluer et de se transformer. Wangel représente au contraire la Vie adulte munie d’une forme invariable qu’elle va maintenir aussi longtemps que les circonstances le lui permettront, et qu’elle n’abandonnera que pour mourir.
Sous le jour de cette idée, l’Etranger et Wangel reflètent et concilient les deux hypothèses biologiques qui ont partagé le siècle et dont Cuvier et Lamarck ont fixé les lignes essentielles : celle de l’invariabilité des espèces et celle de la mutabilité des formes organiques sous l’influence du milieu. Ces deux hypothèses ne font elles-mêmes que traduire le double procédé de la Vie pour vivre. Et c’est, d’une part, un procédé de nouveauté, une tendance à varier et à recevoir les modifications de l’extérieur ; c’est, d’autre part, un procédé conservateur qui maintient et fixe en les répétant les propriétés acquises par la tendance à varier. L’existence simultanée de ces deux forces crée entre elles un antagonisme : mais cet antagonisme est la condition même et le support du phénomène de la Vie. Supprimée la modalité conservatrice, aucune forme ne parviendrait à se manifester, les conditions extérieures en perpétuel changement détruisant à peine ébauchés les avatars d’une substance trop malléable. Mais sitôt que le principe conservateur triompherait en une forme et lui interdirait définitivement de varier, celle-ci serait condamnée à mourir et elle s’éteindrait en effet dès que les conditions extérieures auxquelles elle aurait perdu le pouvoir de s’adapter ne seraient plus compatibles avec son organisation spéciale.
On ne saurait prétendre, est-il besoin de l’exprimer, que le passage de la vie marine à la vie terrestre marque en réalité pour les organismes la fin du pouvoir d’évoluer. Mais on ne saurait douter non plus qu’à une certaine date de la vie organique, ce pouvoir prenne fin; or, c’est cette déchéance que dénonce pour nous l’exode zoologique symbolisé dans la Dame de la Mer. Le triomphe de Wangel sur l’Etranger dans le cœur d’Ellida, voici donc pour nous l’épisode suprême qui soustrait la Vie à l’empire de la tendance à varier et la soumet définitivement à l’action de l’hérédité. Désormais, l’espèce est créée; en elle toute virtualité est éteinte. Elle ne pourra plus recevoir de l’extérieur que des modifications restreintes, celles qui ne lui feront pas perdre son caractère spécifique. Une action trop violente du dehors pourra l’abolir, mais non plus la changer. De ce point de vue, l’espèce pourrait être définie, un organisme parvenu au point de détermination où l’extérieur est impuissant à le modifier. Les espèces que l’on serait tenté de dire nouvelles ne sortiraient donc pas des espèces plus anciennes. Elles prendraient leur origine à une date antérieure à la décision d’Ellida, dans la même matrice où les espèces anciennes ont pris la leur, dans cette matière première de la Vie, docile encore à l’action de l’extérieur. – Telles sont les conclusions qu’il était nécessaire d’enregistrer : car, appliquées au monde moral, elles vont entraîner des conséquences inattendues dont les pièces d’Ibsen seront le commentaire.
Tel est aussi ce drame de la Dame de la Mer dont les décors devraient être brossés en un paysage préhistorique sur les indications d’un paléontologue. Dans nul autre, on l’a remarqué déjà, Ibsen n’a fait d’allusions aussi directes aux lois qui régissent la formation et l’évolution des espèces, Mais cette indication, une fois donnée, va suffire pour évoquer désormais en notre esprit, à l’occasion des autres pièces qui semblent traiter seulement des attitudes morales de la Vie, cette correspondance physiologique.
[1] La Revue blanche